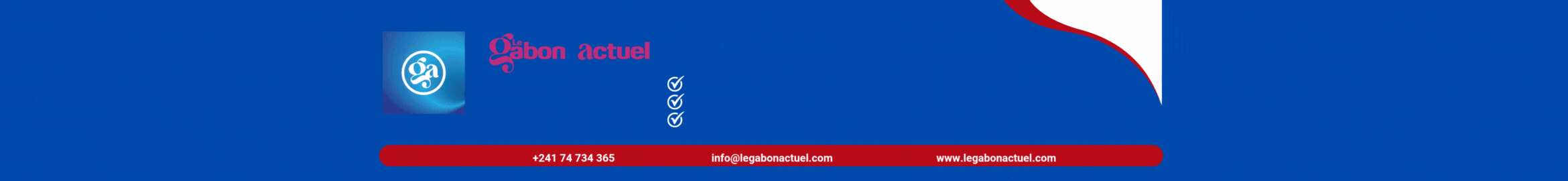Entre traditions séculaires et aspirations nouvelles, les Baka du Gabon amorcent une transformation silencieuse qui redessine leur quotidien sans renier leur identité.
Au nord du Gabon, dans le couloir forestier de Minkébé, la vie des communautés baka évolue à la croisée des traditions et de la modernité. Dans les villages de Bitouga, Doumassi ou Esseng-Elarmitang, les campements installés le long des pistes voient désormais cohabiter les rites ancestraux et des signes d’ouverture sur le monde extérieur. Aux veillées polyphoniques et aux cérémonies rituelles s’ajoutent aujourd’hui des enfants en uniforme, des téléphones portables d’occasion et une préoccupation nouvelle : obtenir un acte de naissance, indispensable pour accéder à l’école et aux services publics.
Installés principalement dans les provinces du Woleu-Ntem et de l’Ogooué-Ivindo, notamment autour de Minvoul et de Makokou, les Baka partagent leur territoire avec les populations bantoues, principalement les Fang. Les échanges économiques et culturels se sont intensifiés au fil des années, même si certains préjugés persistent. La relation longtemps marquée par une hiérarchie implicite tend à s’équilibrer, sans pour autant faire disparaître les stéréotypes. Le terme « pygmée », longtemps employé, laisse progressivement place à l’expression « peuples autochtones », jugée plus respectueuse.
L’accès à l’éducation illustre le mieux cette transformation. Il y a encore une décennie, scolariser un enfant baka restait exceptionnel. Aujourd’hui, de plus en plus de familles franchissent le pas, encouragées par des associations locales qui organisent des collectes pour financer les trajets jusqu’aux écoles parfois situées à plusieurs kilomètres. Les obstacles demeurent nombreux : l’éloignement géographique, l’absence d’actes de naissance ou encore des décrochages saisonniers liés au mode de vie traditionnel.
Cette ouverture au monde moderne ne se fait pas au détriment des pratiques culturelles. La chasse, la pêche et la cueillette continuent d’occuper une place centrale, mais s’accompagnent désormais d’activités agricoles, signe d’une sédentarisation progressive. Les cérémonies comme la danse de l’Ijengui, les consultations des guérisseurs et les chants polyphoniques rythment toujours la vie sociale, témoignant d’une identité qui s’adapte sans se renier.
Sur le plan institutionnel, le Gabon affirme soutenir les normes internationales relatives aux droits des peuples autochtones, notamment la Déclaration des Nations unies, même si la Convention 169 de l’OIT n’a pas encore été ratifiée. En 2025, le Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination raciale a appelé le pays à renforcer la protection juridique des communautés et à les impliquer davantage dans les décisions concernant leurs terres.
Plusieurs initiatives locales cherchent déjà à lever les principaux freins à la scolarisation. Des campagnes d’état-civil itinérantes facilitent l’obtention d’actes de naissance, condition essentielle pour accéder au collège. L’implantation d’écoles bilingues à proximité des villages réduit l’absentéisme et améliore l’apprentissage. Les aides matérielles, telles que les uniformes ou les fournitures scolaires, montrent des effets immédiats sur l’assiduité. Parallèlement, la reconnaissance des droits coutumiers sur les terres contribue à limiter les conflits d’usage et à stabiliser les moyens de subsistance.
Le quotidien des villages traduit cette transition en cours. On y voit un adolescent tresser un filet de pêche pendant qu’une collégienne révise ses leçons à l’ombre d’un manguier. À la nuit tombée, l’écran lumineux d’un téléphone éclaire un visage tandis que résonnent les chants polyphoniques dans la clairière. Entre attachement à la forêt et ouverture sur le monde, les Baka tracent leur voie, faisant de l’éducation un passeport vers l’avenir sans renoncer à leurs racines.