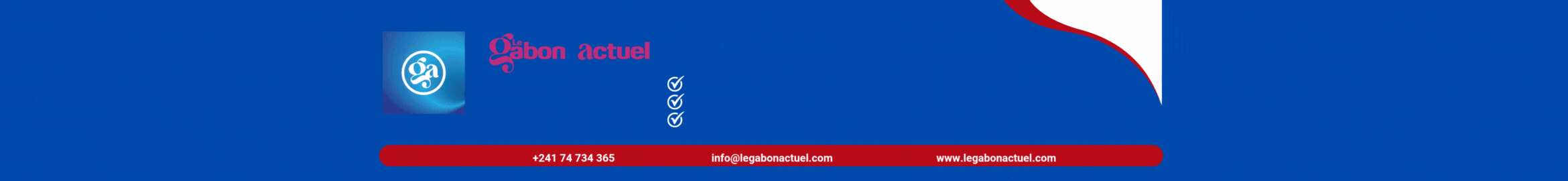Le drame survenu à Bongoville n’est pas qu’un fait divers glaçant : il est aussi le miroir d’un mal plus profond qui gangrène silencieusement notre société. Derrière ce geste incompréhensible d’un homme qui abat sa compagne avant de se donner la mort, se pose une double question : celle des violences intrafamiliales et celle de la régulation du port d’arme, même de chasse.
Combien d’hommes « sans histoire » faut-il encore pour comprendre que l’horreur ne vient pas toujours de profils déviants ou de cas psychiatriques avérés ? Trop souvent, les violences conjugales couvent dans le silence, derrière des portes closes, jusqu’au jour où elles explosent, irrémédiablement. Le drame de Bongoville nous rappelle que ces violences ne sont pas l’apanage des grandes villes ou des couples en conflit ouvert. Elles peuvent surgir là où l’on s’y attend le moins.
À cela s’ajoute un autre facteur, trop souvent négligé : l’accessibilité aux armes. Dans un pays où la chasse est encore une pratique courante, la détention de fusils reste peu encadrée. Or, avoir une arme à portée de main en cas de pulsion incontrôlée transforme un accès de colère en tragédie. Peut-on encore faire l’économie d’un débat sur la nécessité de conditionner la délivrance — ou le renouvellement — d’un permis de chasse à une évaluation psychologique sérieuse et périodique ? Ne serait-il pas temps de considérer que la possession d’une arme, même à des fins dites sportives ou traditionnelles, ne peut plus être un simple acte administratif ?
Ce drame nous engage, collectivement. Il appelle à une réforme lucide, à une volonté politique forte pour briser le tabou des violences domestiques, mais aussi pour réévaluer les critères de détention d’armes. Car si rien ne change, d’autres familles pleureront, d’autres enfants seront laissés seuls, traumatisés à vie.